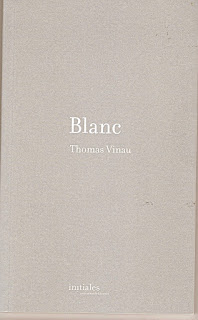« Saint-Simon sut écouter son temps, et s’il ne fit peut-être qu’en entendre la musique, il eut soin cependant de tout mémoriser. Les échos musicaux qui nous parviennent aujourd’hui sont magnifiés par son génie littéraire ; ils ne laissent d’être passionnants, surprenants, et riches de perceptions nouvelles tant sur la période que sur l’auteur lui-même ».
L’écrivain des Mémoires danse et écoute. Le mémorialiste de la Cour se fie tout autant à sa mémoire qu’à son corps. Il écrit comme l’on danse à Versailles – Savoir danser chez le roi, c’était savoir y vivre. Olivier Baumont le lit en admirateur de son siècle et de son art, et le traduit en musicien. Saint-Simon a toujours une oreille aux aguets et une main prête à saisir ce qu’il entend et ce qu’il voit, à la volée dirions-nous, comme un compositeur. Il se glisse au centre de ces divertissements qui font le sel de la Cour, où l’on doit être vu, où se jouent des parties d’échecs invisibles, où se nouent des conquêtes, où se règlent des comptes. Saint-Simon qui n’est jamais dupe de rien, sait les avantages et les risques d’être au cœur du volcan, au centre tellurique du pouvoir, ses Mémoires en prolongent l’écho. Il faudra pour ce livre d’Histoire et d’histoires miser sur l’esquive, mais aussi les sauts et les bonds, tout en gardant l’oreille éveillée et la plume accordée.
« Danser était montrer à tous que l’on est vivant, que l’on était à sa juste place, que l’on tenait son rang, et que l’on défiait guerres, maladies, soucis et tracas ».
« Un jour même, le Roi voulut que tout ce qui étoit à Marly de plus grave et de plus âgé se trouvât au bal, et masqué, hommes et femmes ; et lui-même, pour ôter toute exception et tout embarras, y vient, et y demeura toujours avec une robe de gaze par-dessus l’habit ; mais cette légèreté de mascarade ne fut que pour lui seul, le déguisement entier n’eut d’exception pour personne ».
L’écrivain passe d’un siècle à l’autre, du Grand Siècle à celui des Lumières, d’un bal à l’opéra, d’une messe à Versailles à Notre-Dame d’Atocha avec force tambours, il collectionne des partitions, il écoute ces timbales sonnantes, il note et ne cesse de noter tout ce qu’il voit de son siècle sans se douter qu’il ne cessera d’être lu et relu, par Chateaubriand, Stendhal et Proust – l’auteur consacre dans son Final quelques lignes au Pastiche Dans les Mémoires de Saint-Simon, mais aussi Philippe Sollers, qui ne manque jamais d’en faire un Héros et qui aujourd’hui publie cet Opéra. Saint-Simon musicien ? Saint-Simon amateur au diapason des musiques qu’il croise et qu’il entend ? Olivier Beaumont répond aux questions qu’il se pose, en cadence, comme le Mémorialiste. Le danseur de la cour est familier dans branles, menuets et contredanse, il a assisté à l’opéra d’Issé qu’il juge fort beau et très bien joué, il a encore dans l’oreille les musiques des musiciens du roi à la Chapelle, et les mots de la musique deviennent sous sa plume de justes métaphores – le bruit de leur canon étoit une musique piquante à entendre. Saint-Simon sait que la cour est un théâtre permanent, il en va de même des affaires du Monde, l’écrire c’est le dévoiler, alors il l’écrit. Sa plume, si elle sait être acide, se coule aussi dans l’encre de la douleur, il voit comme personne et saisit comme d’aucuns une perte qui s’annonce : (à propos de la duchesse de Bourgogne) Avec elle s’éclipsèrent joie, plaisirs, amusements mêmes, et toutes espèces de grâces. Les ténèbres couvrirent toute la surface de la cour.
« Cette belle moisson dans les Mémoires est principalement un corpus avec musique plutôt qu’un corpus de musique. Là n’est pas son moindre intérêt : peu d’auteurs peuvent en apprendre autant sur les conditions dans lesquelles celle-ci était perçue, écoutée, entendue et interprétée, dans les nombreux lieux où elle avait sa place. Saint-Simon ne fait pas que rendre compte, il donne aussi son avis en un constant mélange de bienveillance et de malveillance ».
A l’Opéra, monsieur ! est cette belle moisson dans les blés et les chaumes des Mémoires, et Olivier Baumont en lecteur musicien est fidèle à la lettre et aux mots. Il donne à entendre et à voir ce que Saint-Simon a saisi, ce qui l’a troublé, agacé, ce qu’il a ressenti et senti, ce qu’il a esquivé et résumé. Les danses et les chants, les notes et les mots qui ont nourri le récit d’une vie, d’un siècle à la cour, dans les bals et les loges royales. Il nous donne a entendre – et nous invite à lire et à relire les Mémoires sous un nouveau jour, et à entendre de ce siècle : la voix inspirée et splendidement indépendante de l’un de ses auditeurs privilégiés.
Philippe Chauché