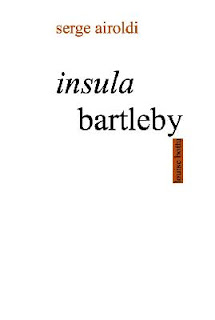mardi 26 octobre 2021
J'ai exécuté un chien de l'enfer de David di Nota dans La Cause Littéraire
mardi 19 octobre 2021
Wonder Landes d'Alexandre Labruffe dans La Cause Littéraire
mercredi 13 octobre 2021
Insula Bartleby de Serge Airoldi dans La Cause Littéraire
« La révolte de Bartleby est une música callada ou bien une soledad sonora, dans quelque nuit obscure jamais apaisée où ne vient aucun détachement, aucune illumination. La révolte de Bartleby ne sert à rien qu’à sa fin même ».
Insula Bartleby est un vibrant et pétillant hommage au roman d’Herman Melville. Un hommage construit comme un puzzle littéraire, où le lecteur croise citations et réflexions, traductions, et impressions de l’auteur sur ce livre étrange, qu’il n’a plus qu’à assembler pour voir apparaître un heureux petit roman tout aussi étrange que celui qui l’a inspiré.
Bartleby d’Herman Melville est aussi ce puzzle, où le lecteur est invité à rassembler ces pièces éparpillées, pour tenter d’en saisir la complexité, l’ampleur, la force d’inertie romanesque du scribe de Wall Street, de voir se dessiner son visage, son corps de clown triste, d’écouter avec grande attention les quelques mots dont il se déleste, et d’en saisir l’humour, comme s’il voyait Buster Keaton campant Bartleby et devenant en un tour de magie cinématographique le scribe de Melville. Serge Airoldi est un chef d’orchestre qui a, face à lui, traducteurs – ces œnologues des lettres – et écrivains, qui à leur tour jouent cette partition silencieuse, cette musique tue, silencieuse, écrivait José Bergamin dans La Solitude sonore du toreo (1), en écho au commentaire de Jean de la Croix sur Le Cantique des Cantiques, comme si Bartleby vivait dans la solitude sonore de son bureau-maison. Il s’agit de se laisser guider par une phrase qui est la phrase fondatrice de ce petit roman, I, would prefer not to, traduite là par : Je
préférerais ne pas ; ici : J’aimerais mieux pas ; ou encore : Je préférerais n’en rien faire ; et ainsi vont les traductions. L’auteur en a relevé dix, toutes à leur manière éveillent en cette langue l’écho de l’original, note Walter Benjamin, qui est lui aussi convié à cette évocation ludique. Les traductions devenant par miracle les échos du roman, de multiples échos. Insula Bartleby est à sa manière savante et savoureuse un écho, un ricochet sur l’eau qui semble calme, du roman de Melville.
« Qui sait où nous conduit Bartleby depuis le refuge de sa grotte, de sa glotte qui gratte et grippe le système ? Sa glotte qui s’interrompt. Qui rompt ».
« Je boutonnai ma jaquette, me redressai ; j’avançai lentement vers lui, lui touchai l’épaule et dis :
“L’heure est venue ; vous devez quitter les lieux ; j’en suis désolé pour vous ; voici de l’argent ; mais vous devez partir.
– Je préférerais ne pas, répliqua-t-il, toujours de dos.
– Vous le devez”.
Il resta silencieux » (Bartleby le scribe, Herman Melville, trad. anglais Jean-Yves Lacroix, Editions Allia).
Serge Airoldi a sous les yeux pour éclairer le roman de Melville, une bibliothèque des plus étourdissantes, des écrivains, des traducteurs et des commentateurs, qui ne manquent pas d’audace, comme l’auteur n’en manque jamais. Il saute de l’un à l’autre, tel un furet des lettres. La figure invisible de Bartleby se dessine page après page, ses mots, son retrait, et ses silences, ses mystères, sa résistance, non au système, mais peut-être à lui-même. Il ne se mure pas dans le silence, mais n’a qu’une phrase à la bouche, qui finit par le conduire en prison, où il n’a plus de mots. Un roman s’écrit face à un mur du silence, comme Bartleby rêveur, simplement arrêté là, sans pouvoir aller plus loin, comme avalé lui aussi par une baleine blanche, et ne pouvant que répondre aux sollicitations des humains qui ignorent tout de sa destinée : I, would prefer not to. A nous d’en déduire ce que l’on souhaite, à nous de l’interpréter comme on l’entend, à nous de prolonger cette énigme sans évidemment être sûr de pouvoir un jour en trouver le sens et la raison. Il n’est finalement pas très raisonnable d’écrire un tel roman, et encore moins de s’y prélasser, d’en faire un petit festin littéraire, Serge Airoldi n’est pas très raisonnable, c’est ce qui fait le charme de son livre.
Philippe Chauché
(1) « Musique pour les yeux de l’âme et pour l’oreille du cœur, qui est la troisième dont nous parlait Nietzsche, celle qui écoute les harmonies intérieures » (La Solitude sonore du toreo, José Bergamin, trad. espagnol, Florence Delay, Fiction & Cie, Seuil, 1989).
http://www.lacauselitteraire.fr/insula-bartleby-serge-airoldi-par-philippe-chauche