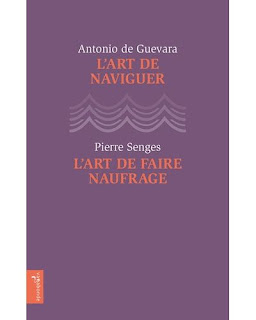mardi 28 septembre 2021
Christian Laborde : Bonheur et Le Bazar de l'hôtel de vie dans La Cause Littéraire
vendredi 24 septembre 2021
Les Bourgeois de Calais de Michel Bernard dans La Cause Littéraire
mercredi 15 septembre 2021
L'art de naviguer d'Antonio de Guevara et L'art de faire naufrage de Pierre Senges dans La Cause Littéraire
jeudi 9 septembre 2021
Une année de solitude de Didier Ben Loulou dans La Cause Littéraire
« Jusqu’à quel âge se sent-on immortel ? Sûrement jusqu’à ce que tu ne puisses plus avancer ni sentir les “onze encens de la beauté du monde” ».
« Être à Jérusalem, c’est avoir choisi d’être définitivement dans la rupture ».
« Tu es accompagné, lors de ton dîner ce vendredi soir, par un petit bouquet de fleurs sauvages qui poussent un peu partout en abondance : fleurs jaunes et oranges, capucines et mimosa. Elles tiennent conversation à ton âme et la tendresse de leurs pétales te fait sentir que la vie ne tient qu’à un souffle ».
Une année de solitude, c’est une année passée à écrire, à lire, à écouter, à parler, à photographier, une année virale qui semble durer un siècle. Une année qui s’ouvre un 12 janvier froid à Paris, un jour sans éclat, où les mots et l’amour s’envolent, les uns reviendront, l’autre qui le sait. Une année qui s’achève un an plus tard par une citation d’Hölderlin : Mais toi, tu es né pour un jour limpide. Une année de solitude à Jérusalem, ce lieu hors de tout, intermédiaire entre ciel et terre ; parfois cloîtré dans son bureau, sur sa petite terrasse, parfois arpentant comme il le fait depuis des années les rues de la vieille ville et ses collines.
L’écrivain-photographe est à l’affût du mouvement invisible des pierres sacrées, des lettres inspirées et inspirantes qu’il découvre sur les pierres tombales, souvent ouvrant un livre et notant dans son journal, une phrase limpide qui va l’accompagner toute l’année durant : Seule la pierre de Jérusalem m’apaise. Ce journal inspiré, parfois touché par la douleur et l’angoisse, est placé sous la haute protection de Benny Lévy, de son ami le vieux rabbi – Tout est miraculeux, même ce qui te semble naturel est de l’ordre du miracle –, du Rabbi Nahman de Bratslav, de Paul Celan, de Camus le méditerranéen, de Walter Benjamin, mais aussi du Zohar. Un bain révélateur d’écrivains et fixateur de livres fondateurs, éclairants, troublants, saisissants, qu’il croise à Jérusalem. L’écrivain-photographe habite sa ville, dont il connaît chaque rue, chaque place, chaque maison, et sa ville se livre comme une offrande, il y est chez lui, comme il est chez lui chez les écrivains qui l’accompagnent durant ce journal Infini. Didier Ben Loulou, quand le confinement ne l’astreint pas à faire le tour de son bureau, est un marcheur, un pèlerin qui se confond avec le paysage qu’il arpente, à sa droite un jeune berger arabe qui surveille ses moutons, à sa gauche un olivier millénaire qui abrite la mémoire de cette terre, dans le ciel un rapace veille sur lui, il arme silencieusement son appareil photographique, il peut viser, cadrer, il est invisible, comme le sont les penseurs Juifs qu’il lit en silence.
« Te tenir toujours là-bas au loin pour voir si tes rêves y sont ».
« Atteindre la clarté, voilà ce qui te motive le plus dans tes images ».
« Le vieux rabbi : De quoi a-t-on besoin dans cette vie ? De pain et de livres ».
Didier Ben Loulou a écrit son journal du deuil de l’amour, de l’amour en fuite, mais aussi un journal des passions vives, celles d’écrivains, de collines, de fleurs, de visages, de pierres, de villes, du Sud, et de phrases qu’il saisit, comme il saisit un visage ou le mouvement de la mer Méditerranée. Ce journal est une confession, un dialogue intérieur qui s’articule autour d’heureuses citations d’écrivains et de penseurs Juifs qui habitent sa vie errante, sa mémoire et les photographies qui l’accompagnent. Il a composé son journal avec l’attention d’un imprimeur-éditeur avisé et savant, choisi les polices d’écriture des citations, leur articulation, leur résonance, et ainsi, il fait parler son journal, pour nous faire voir ce qu’il voit et ce qu’il ressent. Une année de solitude est à l’image de la photo de couverture du livre : sol pierreux où quelques herbes poussent, un arbre recouvert de fleurs blanches, sous un ciel que se partagent nuages et éclaircies. Durant un an, les nuages ont assombri la vie de l’écrivain-photographe, mais sans que le bleu du ciel ne s’estompe. Durant un an, il a noté ses impressions, son ressenti face à la pandémie, et à sa vie un instant mise sur pause, recopié des citations et des confidences, cadrant sa vie, pour la réenchanter et sentir à nouveau les « onze encens de la beauté du monde ».
Philippe Chauché
http://www.lacauselitteraire.fr/une-annee-de-solitude-didier-ben-loulou-par-philippe-chauche