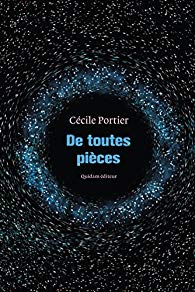« Savoir ce qu’on fait : un fatras agencé au millimètre près, avec dedans un paravent peint d’oiseaux, des bêtes à poil et à griffes, dont une loutre, pour la beauté enfin stoppée, réalisée, de sa nage, et des bocaux sur des étagères scellées dans de la menuiserie sombre aux mécanismes d’ouverture plus subtils que compliqués, s’offrant seulement aux doigts fins. Des surprises, des terreurs, des onguents, des mèches de cheveux de concubines d’un harem, type Angélique Marquise des Anges ».
De toutes pièces est le roman de ce fatras, de cette collection amoncelée, de ce cabinet de curiosités qui sous nos yeux s’imagine, s’agence dans le hangar d’une zone commerciale oubliée, loin de tout, tenue secrète, sans que jamais l’on ne sache pourquoi et pour qui. Les commanditaires de ce musée imaginaire et improbable sont invisibles. Ils donnent des ordres et contrôlent via une interface sécurisée tout ce qui entre, tout ce qui est répertorié par le narrateur, ce collectionneur qui va passer une année à faire naître cet étrange cabinet romanesque. Ce musée de la Terre et du Monde l’occupe jour et nuit et son journal devient ce troublant roman. Il commande, achète et classe, un monde étrange et extravagant se dessine en pointillé, jour après jour, sans que l’on sache à quoi cela va nous conduire et l’entraîner.
« Livraison aujourd’hui d’une pièce de sublimation, d’orfèvrerie : une oreille humaine, coupée, enchâssée dans du ciment réfractaire, coulée directement avec du métal en fusion, qui littéralement la remplace. Quand tout est durci, on casse le moule, on récupère. On s’extasie des ourlets, des circonvolutions. Le lobe semble encore doux et duveté, on voudrait s’accrocher comme l’amant, le téter ».
Ces pièces de sublimation s’accumulent, plus surprenantes les unes que les autres : un essaim d’abeilles figé dans une résine très transparente,une petite saucière à décor polychrome de fleurs, filets dorés et dents de loups sur les bords, le squelette d’une femme girafe, une graine de lotus sacré, vieille de mille trois cents ans, un homme sauvage, poilu, très. Sa tête est absente. Pas coupée, non. Simplement, il n’a pas de tête, un cil de Marilyn Monroe, une DS miniature, une belle collection d’instruments de torture, de tous temps et de tous pays, et l’inventaire pourrait se poursuivre indéfiniment. Une pièce chasse l’autre dans l’imaginaire de Cécile Portier, étrange bestiaire, placé sous haute surveillance. De toutes pièces est un roman en noir et blanc de la raison perdue, du dérèglement, et d’une part d’absurde, le roman d’une guerre secrète – d’une manipulation – que le narrateur pense maîtriser jusqu’à son effondrement, premier signe de sa disparition : Je suis le soldat d’une tranchée froide, sur un front oublié.
« Mon univers est ce hangar. C’est une sorte d’aboutissement, la récompense de tous mes efforts. C’est l’ironique punition qui m’échoit, d’avoir voulu jouer sur tous les tableaux. Le monde s’est rétréci, il n’y a désormais plus qu’un seul tableau : ce tout petit morceau d’espace-temps englué, quadrillé ».
Etourdissant univers, que celui de Cécile Portier, porté par un style vif, précis, très concentré – comme un poison –, sec, où par instants, pointe l’effroi. Ses phrases sont dotées de cette capacité de faire voir sur l’instant ce qui se joue, par leur clarté, leur rythme, leur cadence, de faire entendre la chute qui s’annonce. De toutes piècesest un roman électrisant.
Philippe Chauché
http://www.lacauselitteraire.fr/de-toutes-pieces-cecile-portier-par-philippe-chauche